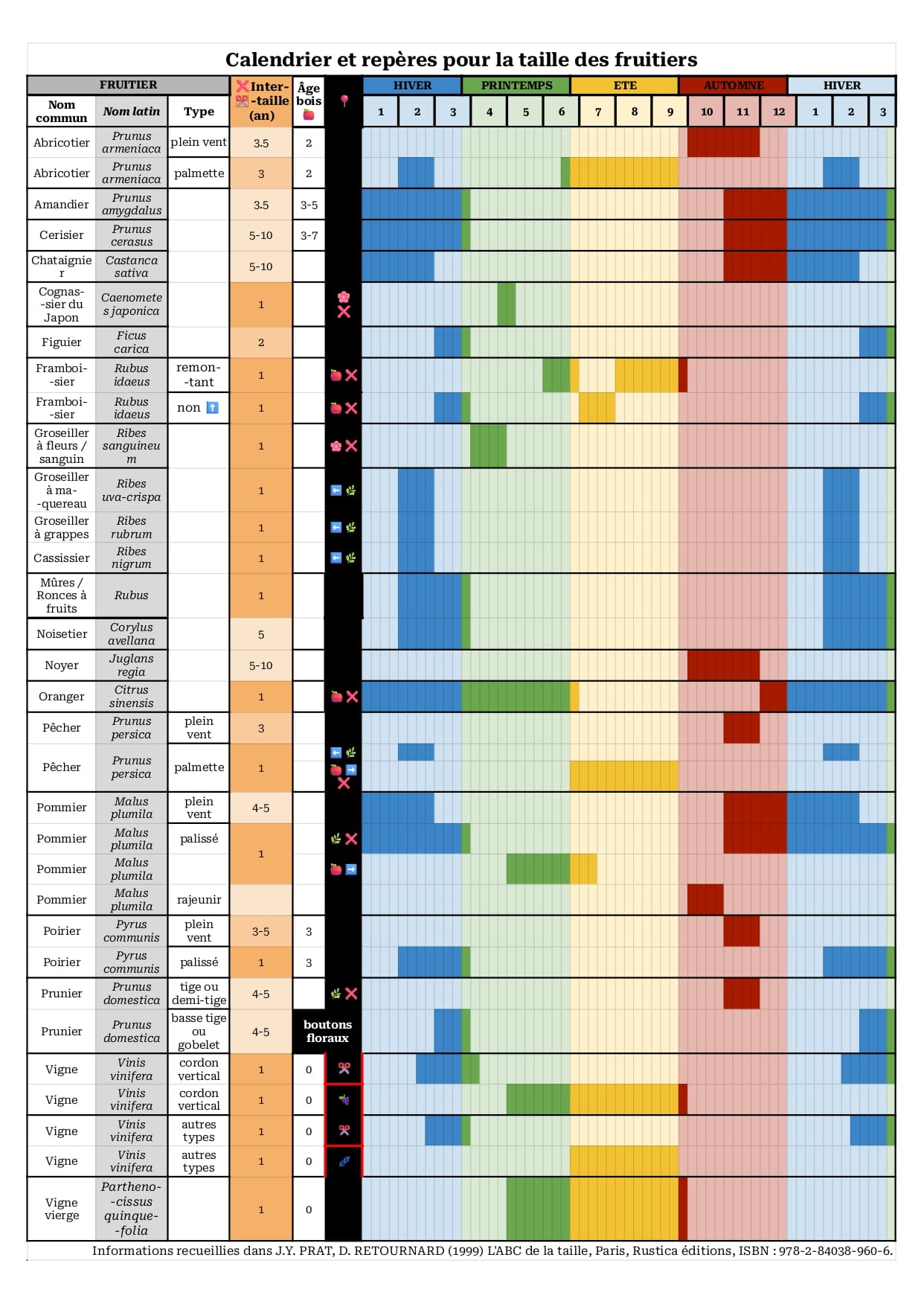Pourquoi écrire ce texte ?
Nous sommes nombreux·ses sur le lieu à avoir de l’experience militante avant de venir habiter au Mallouestan. Nous sommes nombreux·ses à compter notre déception à l’égard de ces experiences comme faisant partie des causes de notre venue sur le lieu. Cette déception et nos diverses critiques, constructives dans l’intention, font régulièrement partie des discussions sur le lieu avec notamment les visteur·ices. Ce texte a pour raison d’éclaircir ces échanges qui parfois, probablement souvent par notre faute, ont pu ne pas être des plus clairs ou adroits.
Ce texte, tout comme les autres que nous avons écrits abordant notre vision, notre cadre ou nos objectifs, permet de partager et de rendre disponibles nos réflexions et pensées. Cette substance, une fois accessible, permet également de la rendre examinable et critiquable. Effectivement, un de nos objectifs est certes de les partager, mais nous n’envisageons aucunement ces contenus comme étant immunisés contre nos méprises ou erreurs. Il nous semble donc important de les faire évoluer au travers des regards extérieurs que ces textes, notamment celui-ci, rendent possibles. Nous écrivons donc ce texte pour diverses raisons : nous souhaitons qu’il soit accessible, instructif et régulièrement remis en question, mais également écarter les caractérisations de type homme de paille [une caractérisation fausse en simplifiant ou stéreotypant une position] nous prêtant à tort des positions simplifiées sur ces sujets.
De quoi allons-nous parler ?
Nous allons aborder dans ce texte différentes critiques à l’égard des milieux militants. Celles-ci ne reflètent en aucun cas un jugement de notre part à l’égard des individu·es qui militent dans les contextes que nous allons questionner. Elles sont exprimées surtout pour expliquer notre analyse en espérant qu’elles contribuent à l’amélioration des luttes. Nous allons expliquer dans ce texte notre vision de comment nous souhaitons que le Mallouestan s’inscrive dans le monde militant. Nous allons commencer par définir quelques repères pour ensuite pouvoir être le plus constructif·ves possible.
Une grille de lecture
Militantisme offensif vs défensif
Nous allons utiliser une distinction dans ce texte qui nous semble pertinente pour caractériser les différentes stratégies militantes : celle du militantisme offensif opposé au militantisme défensif. Cette caractérisation est appliquable aux stratégies militantes et non à leurs tactiques. Les tactiques ici désignent les modus operandi seuls, hors contexte, comme la manifestation, le sabotage, les sit-ins ou encore le collage. Ces exemples de tactiques sont des outils qui peuvent être utilisés quand ils sont jugés pertinents. Une stratégie, quant à elle, définit le plan d’action, des objectifs, les tactiques pour les atteindre, la temporalité et plus généralement, le cadre. Une tactique ne définit pas le caractère offensif ou non d’une action ou d’un groupe militant. C’est au niveau stratégique que cela se joue.
Est-ce que la stratégie prévoit principalement de s’attaquer à des choses structurelles, comme le sexisme ? Si oui, elle serait sous-tendue par un mouvement offensif. Contrairement à, par exemple, un mouvement prenant en charge des personnes victimes de violences, qui serait donc un mouvement défensif. Effectivement, l’objectif est d’aider certaines personnes sans attaquer la racine structurelle. Avant de continuer il faut nuancer quelques points. Premièrement, un mouvement n’est pas qu’offensif ou défensif, mais est sur un spectre entre ces deux absolus. Deuxiemement, il n’est pas ici question de comparer ces deux natures entre elles et d’en valoriser une aux dépens de l’autre, mais de simplement créer un outil descriptif. Prenons quelques exemples pour mieux illustrer ce dualisme :
- Une Z.A.D est principalement défensive, et n’a pas d’objectif à long terme une fois qu’un projet est annulé. Ce n’est pas pour autant que rien d’offensif ne naît dans ces espaces.
- Un mouvement écologiste comme Extinction Rebellion cherche à changer, au niveau de plusieurs pays, la législation, la gouvernance, et l’interêt porté au dérèglement climatique. Ce mouvement est donc principalement offensif, malgré des actions défensives sur le terrain (souvent en partenariat avec d’autres associations). Mais la stratégie de XR de bloquer les routes (tactique) et de sit-ins (tactique) a comme objectif d’établir un rapport de force avec les corporations et avec l’Etat.
- Un sanctuaire pour animaux est défensif, car il cherche à protéger quelques individus.
- Un mouvement qui mène des bloquages d’abattoirs comme ce que fait 269 Libération Animale cherche à créer un rapport de force avec l’Etat et les entreprises d’exploitation animale. C’est un mouvement dont on peut dire que la stratégie est notamment offensive.
Guerre de position et guerre de mouvement
En s’inspirant du vocabulaire militaire et dans le contexte de l’après-Première Guerre mondiale, Gramsci distingue la guerre de position de la guerre de mouvement. Pour lui, la guerre de mouvement se caractérise par une action frontale, souvent insurrectionnelle. Elle s’inspire de la tactique militaire où l’on cherche à percer les lignes ennemies par une attaque soudaine et décisive. Gramsci a en tête l’exemple de la prise de pouvoir par la force des bolcheviks en 1917. Il ne croit cependant pas en cette stratégie dans le cadre du contexte occidental dans lequel il se trouve (l’Italie). En effet, selon lui, la révolution de 1917 doit sa réussite au fait que le pouvoir en place était faible et ne possédait pas une hégémonie suffisante — contrairement aux institutions et idéologies occidentales. Il préconise donc la guerre de position. Autrement dit, la guerre de position est le fait de propager une vision et un rapport au monde dans la population ou dans certains cas, en position de faiblesse notament, de maintenir des bribes ou des éléments de cette vision dans le sens commun.
Pour comprendre cette notion, il faut en présenter d’autres, notamment les concepts de sens commun et d’hégémonie, que Gramsci a développés. Selon lui, certain·es acteur·ices de la société produisent des connaissances ou jouent un rôle dans leur transmission : il les appelle les intellectuel·les. Ces acteur·ices participent à l’élaboration d’un prisme collectif partagé à travers lequel nous abordons et concevons le monde — ce que Gramsci appelle le sens commun. Celui-ci est un mélange d’idées, de croyances, de préjugés et de valeurs que les individu·es ont adopté·es. Il est le produit, notamment, de la culture et de l’éducation.
L’hégémonie est la vision du monde qui s’impose comme “normale” dans ce sens commun. Elle correspond souvent à la vision souhaitée par la classe dominante. Autrement dit, les idées de la classe dominante deviennent les idées “évidentes” ou “naturelles” pour tout le monde, y compris pour les classes dominées. Dans ce cas, Gramsci dirait que la classe dominante détient l’hégémonie.
Attention : le concept d’hégémonie culturelle est fréquemment employé, parfois instrumentalisé, mais il ne constitue qu’une composante de l’hégémonie selon Gramsci. Ce dernier y ajoute notamment l’hégémonie morale ou l’hégémonie intellectuelle. La culture étant un outil puissant pour façonner de nombreuses autres formes d’hégémonie, elle reste un élément crucial (voir texte “Culture”).
Mais l’hégémonie peut aussi être le fait d’un autre groupe que celui des dominant·es. Dans ce cas, pour Gramsci, il est possible de renverser le groupe en place. L’absence d’hégémonie pour les groupes révolutionnaires explique, selon lui, pourquoi les révolutions socialistes prévues par Marx n’ont pas eu lieu dans les sociétés capitalistes avancées : les travailleuse·eurs y ont intégré les valeurs de la bourgeoisie, au point de ne plus remettre en cause l’ordre établi. Gramsci appelle donc les communistes à construire leur propre hégémonie, sans laquelle iels ne peuvent espérer l’emporter. En d’autres termes, pour lui, le prérequis à la victoire politique est que les prolétaires aient intégré, dans leur vision du monde, un rapport et des valeurs marxistes. Cet effort militant à l’égard de l’hégémonie constitue le terrain de ce qu’il appelle la guerre de positions.
Quadrant
Nous pouvons combiner ces concepts avec les notions d’offensif et de défensif pour obtenir une grille d’analyse riche du militantisme :
| Offensive | Défensive | |
|---|---|---|
| Guerre de positions | Atteindre l’hégémonie ou y tendre, changer l’axiologie structurelle | Maintenir dans le sens commun des valeurs chères |
| Guerre de mouvement | Révolution, renversement d’une oppression structurelle par la coercition | Zone à défendre, Stratégie de blocage de mines.. |
Atteinte de l’hégémonie
Pour qu’une lutte de type guerre de mouvement offensive soit efficace, il faut qu’elle puisse créer un rapport de force avec ses ennemi·es, et ensuite le faire perdurer suffisement longtemps. Pour maintenir ce rapport de force, il est nécéssaire d’obtenir une hégémonie suffisante. Cela peut être accompli par deux grandes méthodes. La première est d’obtenir l’hégémonie avant la prise de pouvoir, permetant ainsi de la justifier par la suite. La deuxième est de prendre le pouvoir et ensuite de développer l’hégémonie suffisemment rapidement. Il faut noter que dans ce deuxième cas il faut préalablement à la prise de pouvoir une masse critique soit un nombre suffisant de personne adhérant a ces objectifs pour réussir la prise de pouvoir malgré l’absence d’hégémonie (incluant les membres de son mouvement et les personnes non membres mais suffisement convaincues).
| Phases | Hégémonie avant la prise de pouvoir | Hégémonie après la prise de pouvoir |
|---|---|---|
| Phase 1 | Obtenir l’hégémonie | Obtenir une masse critique suffisante |
| Phase 2 | Amener les changements, de façon probablement plus douce | Imposer des changements de façon probablement coercitive |
| Phase 3 | Faire perdurer les changements | Installation/obtention de l’hégémonie |
| Phase 4 | - - - - - | Faire perdurer les changements |
La phase 3 et 4 sont nécéssaire si et tant qu’il y a risque de retour en arrière. Autrement dit, si les changements sont fragiles et peuvent être annulés par un changement de régime ou de politique.
L’exemple de Mao Zedong peut illustrer la deuxième colonne. Effectivement, Mao Zedong a pris le pouvoir en 1949 sans avoir l’hégémonie. Il a ensuite mis en place des changements structurels et politiques qui ont permis de faire perdurer son pouvoir. C’est grâce au fait qu’il a réussi à installer l’hégémonie de son parti et de ses idées après sa prise de pouvoir; notamment dans ce qui est appelé la Révolution culturelle.
Notre vision au Mallouestan
Les petits gestes
Nous avons croisé, que ce soit avant le Mallouestan ou depuis, sur le lieu, de nombreuses personnes qui militent au travers, très souvent à l’échelle individuelle, d’actions, de pratiques ou de revendications que nous pourrions caractériser de petits gestes. Cela inclut, par exemple, le tri des déchets, les pipis sous des douches courtes, le véganisme, la vasectomie ou s’interdir de prendre l’avion. Ces pratiques sont parfois associées à une prétention offensive. Autrement dit, ces actions contribueraient, par collibrisme [accumulation de toutes ces pratiques, popularisées notamment], à un changement politique de grande ampleur. L’exemple de la campagne de communication de Biocoop “Manger bio est un geste politique” est un exemple particulièrement représentatif de cette idée1.
Nous rejetons fermement cette prétention associée à ce genre de pratiques. C’est une vision qui s’inscrit parfaitement dans la logique libérale du système2 capitaliste occidental (voir le texte “Anti-libéralisme”). Effectivement nous n’adhérons pas au fait de penser que sans organisation politique mais plûtot par cumulation de simples volontés individuelles nous arriverons à changer dans le bon sens des logiques structurelles et systémiques.
Historiquement aucun changement social majeur (droits des femmes, abolition de la ségrégation raciale, …) n’a utilisé ces tactiques individuelles de façon efficace dans des stratégies offensives. Au contraire, ce sont ces logiques qui ont amené à des échecs et à des contradictions, bénéficiant surtout au système3. Souvent, cela créé des marchés, où l’état et les entreprises capitalistes s’appuient sur ces logiques. Nous l’avons vu, ci-dessus, avec l’exemple de Biocoop, mais c’est également le cas avec le véganisme, où un marché entier de produits est né. Une majorité de vegans achète des produits à des entreprises, qui par ailleurs exploitent les non-humain·es, et qui sont dépendants d’une chaine industrielle et d’exploitation conséquente : c’est à se demander si ces produits sont vraiment vegans, car pour exister ils ont nécéssité, certes seulement de manière collatérale, le sacrifice de non-humain·es et d’écosystèmes.
La sensibilisation et l’éducation
Une deuxième stratégie que l’on a croisée est celle d’éduquer et de sensibiliser en masse les personnes aux réalités des injustices et de l’ignomie (caractère ignoble) de ce qui nous entoure, dans l’optique de changer à grande échelle les divers rapports problématiques. Cela passe par des tactiques comme la sensibilisation de rue, les collages, les interventions dans les écoles ou entreprises, les “cubes de la vérité” pour des associations animalistes et de nombreuses autres méthodes. Cette stratégie s’inscrit parfaitement dans la perspective de guerre de position.
Les stratégies dans lesquelles ces tactiques s’inscrivent nous semblent inefficaces. Dans un premier temps, l’histoire ne convainc pas de leur utilité. Par exemple, cela fait cinquante ans que nous éduquons sur la réalité du dérèglement climatique. Cinquante ans que des militant·es, en occident notamment, sont dans les rues régulièrement, que dans les écoles des interventions sont effectuées pour sensibiliser, que les programmes scolaires accordent une place à la question et que les médias (documentaires, internet) sont utilisés pour éduquer. Cela fait cinquante ans aussi que la priorité de cette lutte baisse. Après cinquante ans de luttes il y a moins de personnes qui trouvent la question climatique prioritaire qu’en 19704. Il y a en France, début 2025, soit 55 ans après le premier “Earth Day”, entre 38% et 45% de climatosceptiques. Des constats similaires pourrait être émis dans de nombreuses autres luttes.
La sensibilisation et l’éducation est aussi limitée par notre capacité à convaincre. Force est de constater que notre capacité est bien moindre face à nos ennemis politiques, qui détiennent la majorité des médias, du pouvoir politique et des moyens en général. La sensibilisation et l’éducation à l’échelle du militantisme actuel est simplement illusoire. Nous critiquons ici la stratégie et non la tactique. Autrement dit, la tactique, si elle est mise en place librement, peut potentiellement être efficace, mais la stratégie, elle, doit intégrer les contraintes et les limites du contexte dans lequel elle se déploie. Ce qui veut dire qu’il est inefficace de tenter des tactiques dans certains contextes. Dans le cas de l’éducation et de la sensibilisation, il ne sert à rien de s’acharner si nous n’avons pas les moyens suffisants pour contrer les mécanismes de défense de nos ennemi·es politiques. De fait, aujourd’hui, le peu qui est fait est très facilement contournable par les différentes puissances auxquelles nous sommes opposé·es, comme le démontrent les différents évènements politiques récents : Trump aux États-Unis, Orban en Hongrie, ainsi que la montée de l’extrème-droite en France.
De plus, même si la sensibilisation et l’éducation réussissent leurs objectifs intermédiaires, pour autant ce n’est que rarement suffisant pour amener les changements espérés. Effectivement, le fait que de nombreuses personnes comprennent des enjeux ne suffit pas pour amener une mobilisation qui, même quand elle voit le jour, doit être efficace à son tour. Si cette stratégie veut réussir, il faut que le milieu militant vise une guerre de position radicale où l’atteinte de l’hégémonie est prise en compte, ou qu’il change de tactiques et adopte une approche de guerre de mouvement, comme présenté ci-dessus. Une feuille de route doit intégrer plus que l’hégémonie intellectuelle et de connaissance. Nous ne pouvons pas convaincre de façon fragmentaire, il faut un front cohérent et total.
Le militantisme offensif radical
Le militantisme radical se définit notamment par l’intention de s’attaquer à la racine des différents problèmes. Dans le cas des déchets, dans une optique radicale, on favoriserait au tri le fait de s’attaquer à la production même de ces déchets. Nous nous reconnaissons dans ce genre d’analyse. Le fait d’avoir une analyse globale permet d’identifier les causes structurelles d’un problême et de ne pas se limiter á ses symptômes. Adresser un problème ainsi identifié nous semble être la meilleure façon d’avoir un impact à une échelle importante. Pour autant, la difficulté est d’avoir les moyens de s’attaquer à ces problèmes. De là vient notre déception principale car nous sommes convaincu·es que les milieux militants occidentaux n’ont pas ces moyens.
La plupart des collectifs que nous avons rencontrés, bien qu’ils se revendiquent d’une posture « radicale », peinent à formuler une stratégie cohérente et articulée. En l’absence de cadre structuré, ils se contentent généralement d’une approche empirique, voire ponctuelle, selon les circonstances. Ces mouvements mobilisent des tactiques souvent dépourvues des ressources nécessaires à leur efficacité, procédant à des ajustements au fur et à mesure, sans vision d’ensemble. En définitive, cette dynamique débouche sur une radicalité d’intention qui demeure essentiellement déclarative, faute de leviers concrets pour en réaliser les ambitions. Il ne suffit pas d’adopter une rhétorique offensive ou de se proclamer radical·e pour incarner véritablement ces principes dans les faits.
Parmi les très rares collectifs ayant entrepris une analyse rigoureuse des faiblesses et des impasses propres aux luttes contemporaines, d’autres obstacles majeurs se manifestent. Une forme de résistance émerge au sein de groupes pourtant susceptibles d’être considérés comme alliés, tandis que des dynamiques de concurrence s’installent entre les collectifs eux-mêmes. Ces quelques groupes semblent avoir fait le choix — que nous comprenons — de privilégier une stratégie fondée sur la masse critique, plutôt que sur la recherche d’une hégémonie initiale. Dans ce contexte, nos interrogations ne portent pas tant sur leur capacité à convaincre ou à mobiliser ladite masse critique (là où ce serait le cas dans une logique d’hégémonie initiale), que sur leur aptitude à impulser des transformations pérennes. En effet, maintenir une position suffisamment durable pour garantir l’irréversibilité des changements souhaités représente, selon nous, une difficulté comparable à celle de l’établissement d’une hégémonie initiale. Certains collectifs fondent leur espoir sur l’existence d’une impossibilité matérielle de retour en arrière ; or, il nous semble que l’évolution des formes de conflictualité, en particulier les nouveaux types de guerres, a conduit les États à développer de nombreuses redondances aux réalités matériels qui sous-tendent nos sociétés.
Absence des prérequis matériels
Effectivement, nous pensons que les conditions matérielles ne sont pas réunies pour que ces stratégies réussissent. Nous pourrions lister de façon non-exhaustive :
- Un manque de compétences chez les militant·es ;
- Une approche libérale et de consommation du militantisme. Le militantisme est plus un hobbie pour de nombreureuses militant·es. Certain·es militant·es militent, mais seulement si leurs privilèges ne sont pas mis à mal. D’autres, parfois les mêmes, militent à des fins thérapeutiques et le consomment comme de nombreuses autres sources de bien-être ;
- Un manque d’effectif important, notamment pour les tactiques utilisées ;
- Des aspects identitaires délétères aux pratiques militantes (voir texte “Ontologie, matérialisme et ésoterisme”) ;
- Une difficulté à faire corps autour d’objectifs radicaux sans que les rapports de puissance inter-individuels ne viennent diviser. L’hégémonie actuelle fait que des groupes passent plus de temps à s’engager dans des hostilités horizontales et faire la “guerre” à d’autres groupes qu’à leurs ennemi·es politiques de base ;
- Une absence de pouvoir et de rapport de force face à des ennemi·es bien plus puissant·es ; qui par ailleurs ont toute la légitimité de la violence et de la justice (qui n’est même pas nécessaire dans l’absolu) ;
- Une absence de compétences dans la création de collectifs où l’équilibre nécessaire n’est pas trouvé entre soin des militant·es et efficacité sur le terrain.
Nous partageons le constat de “Full-spectrum résistance”5 que très peu de luttes offensives ont réussi, dans ces cinquantes dernières années en Occident, à apporter des changements solides. Les luttes les plus efficaces sont probablement celles des milieux LGBTQIA+, et pourtant, parmi le peu de victoires, de nombreuses restent fragiles et dépendent du contexte politique. Simone de Beauvoir affirmait : « Rien n’est jamais définitivement acquis. Il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilantes ». Effectivement, des changements de régimes ou d’orientation politique ont récemment renversé et annulé des dizaines d’années de militantisme. Nous pouvons par exemple citer la question de la représentation LGBTQIA+ dans l’espace public dans certains États des États-Unis-d’Amérique, ainsi que la Hongrie où (en mai et en décembre 2020 ainsi que le 15 juin 2021) des lois à caractère discriminant à l’égard de la communauté LGBTQIA+ ont été votées (dans un pays Européen). Ceci est un exemple où les phase 3 et 4 (comme mentionné dans le tableau dans la section “Atteintes de l’hégémonie”) n’ont pas était accomplies. Effectivement, les changements ont été fragiles et n’ont pas perduré.
Laclau et Mouffe développent un ensemble de conditions permettant le changement social. Pour ces deux auteurs, qui s’inscrivent dans une vision gramscienne, il est essentiel de construire un narratif regroupant les différentes formes d’oppressions (sexisme, racisme, rapport anthropocentriste au vivant, etc.), un narratif agile et flexible. Il est crucial, dans leur vision, que ce dernier puisse reconnaître et intégrer facilement de nouvelles analyses ainsi que de nouvelles oppressions, en raison de ce qu’iels appellent l’indétermination du social.
L’indétermination du social, pour Laclau et Mouffe, implique que le social n’est jamais clos ni figé : il est toujours ouvert à la reconfiguration. Le narratif à développer doit donc accepter cette instabilité et construire des articulations politiques dans un champ en perpétuelle mutation. Il doit avoir pour prétention l’hégémonie. Cette hégémonie doit également intégrer une approche discursive et critique, où peuvent exister des confrontations légitimes entre projets politiques opposés, sans chercher à les effacer. Pour Laclau et Mouffe, ce n’est qu’ainsi que l’on pourra initier des changements sociaux solides.
Force est de constater que ni ce narratif, ni ces espaces discursifs n’existent dans le paysage militant, du moins dans celui que nous connaissons. Il existe des espaces de conférences et de retrouvailles, des lieux d’entre-soi, des espaces d’autovalidation et de culture du biais de confirmation. On passe la majorité du temps à répéter les mêmes choses à des personnes déjà convaincues. Malgré cet entre-soi — ce raccourci permettant de contourner la diversité des points de vue — il n’existe toujours pas de narratif englobant. Le problème n’est pas seulement que ce narratif n’est pas hégémonique : c’est qu’il n’existe même pas dans les milieux militants, où chacun·e reste concentré·e sur son sujet de prédilection.
Qu’en est-il des luttes défensives ?
Les luttes défensives ont une volonté toute autre. Elle permettent de protèger un espace, des personnes ou des droits de façon plus restreinte. La lutte défensive a de nombreuses victoires avec de réels impacts à des échelles locales. Nous pensons qu’elles sont insuffisantes sur le long terme mais qu’elles ont toute leur importance en attendant des victoires offensives, ou un contexte les permettant. Sur le long terme, cela s’apparente au jeu de tape-taupe, ou à couper des tête d’hydre, où les échecs permettent à nos opposant·es de grignoter du terrain ou des droits. Mais cela est assurément mieux que rien.
Les luttes défensives sont aussi concernées par de nombreuses critiques présentes dans ce texte, et ont de nombreux défis à relever. Il est récurrent que de l’effort militant soit gaché sur des luttes qui ont peu ou pas de chances de succès. On peut penser aux différentes luttes allemandes, comme Dannenröder (Danni) ou encore Ende Gelände.
Les militant·es traîtres
Un autre frein du militantisme est la séduction de la part du système envers des militant·es. De nombreuses personnes, après des années de militantisme, se retrouvent à soutenir, participer activement et profiter des mêmes institutions qu’elles décrient sur le terrain. Un exemple parlant pourraît être les éléments les plus radicaux des “Chicago Seven” qui devinrent traders, financiers et politiciens, profitant de fait de l’argent créé par divers marchés militaires auxquels ils s’étaient pourtant opposés politiquement pendant leur procès. Michel Clouscard cite les soixante-huitard·es comme exemple, en décrivant une majorité des mouvements étudiants qui composent maintenant une partie de l’élite de la France.
Un demi siècle plus tard, le désengagement militant ne s’est qu’accentué, en créant un sérieux frein aux milieux militants. Ici, on ne parle pas que d’un désengagement, bien réel, dû au nombreux problèmes internes aux mouvements, luttes et collectifs, mais plus spécifiquement d’un désengagement suivi d’un conformisme social important. Les milieux militants étant composés d’un nombre important de petit·es bougeois·es de classe “moyenne” ou de rares bourgeois·es “éveillé·es”, ce conformisme, cette rentrée dans le rang, implique la reproduction sociale inhérente au système. Effectivement, de nombreux·ses militant·es deviennent cadres, ingénieur·es, financier·es, ou politicien·nes, et rejoignent le front du productivisme qui artificialise, esclavagise, et détruit les habitats et habitant·es de la Terre.
Les méprises subversives
L’avant-dernier point qui nous semble important à relever est l’impression, pour nous l’illusion, de subversivité que de nombreuses luttes véhiculent. Cette impression découle de l’idée qui peut se résumer ainsi : les actions sur le terrain, quelle que soit leur efficacité, seraient mieux que de ne rien faire. Cette idée est parfois soutenue par celleux qui préfèrent manifester malgré les chances - qu’iels reconnaissent comme extrêmement faibles - de changer quoi que ce soit. Ces manifestant·es cherchent parfois, en choisissant cette stratégie, à montrer à nos ennemi·es qu’iels ne se laissent pas faire. Parfois, c’est parce que malgré le manque d’efficacité reconnue, les militant·es préfèrent agir plûtot que de “baisser les bras”. Nous nous opposons à ce “bougisme” pour les raisons ci-dessous :
-
La démultiplication des tactiques, des luttes, et de fait des actions, ne les renforce pas systématiquement. Certaines stratégies, incluant donc les objectifs, ne sont pas compatibles entre elles. Un effort conséquent est gaspillé à combattre d’autres stratégies, parfois sans même le savoir. Certains mouvements seront utilisés pour en discréditer d’autres, surtout par nos ennemi·es commun·es. Parfois, ce sera en érigeant une lutte comme légitime plutôt qu’une autre. Certaines stratégies n’ont pas besoin d’être instrumentalisées pour nuire à d’autres, leurs différences d’objectifs suffiront car elles sont parfois contraires - ou, au mieux, incompatibles. Le fait de militer ainsi revient à un jeu de tire à la corde où les différent·es acteurices tirent toustes dans des directions opposées. Cela amène à un immobilisme, qui contraste pourtant avec l’intention.
-
La somme des actions sur le terrain n’est pas obligatoirement positive ou neutre. Autrement dit, le fait de militer sans regard quant à l’efficacité, ne créé pas obligatoirement au pire des cas un statu-quo, notamment en cas d’échec. Reprenons l’exemple de manifester, où parfois certain·es le font pour s’entrainer à la confrontation policière. Pourtant, ce qui semble être oublié est que ces actions entrainent les deux camps. Malheureusement, le camp opposé a, lui, des capacités d’archivage, financière, logistique, légale et technologique qui lui permettent de réellement apprendre, et de s’améliorer. De plus, il est évidement que, lors de confrontations répétées, nos ennemis politiques cherchent à s’en prémunir. Il suffit de regarder les cinquantes dernieres années de manifestations pour comprendre que les CRS, notamment au travers de leurs équipements, ont appris bien plus que les manifestant·es.
Ces deux problèmes sont accentuéś par ceux explicités ci-dessus. Prenons comme exemple le “turn-over” conséquent chez les militant·es, où l’expérience est simplement perdue lors des départs.
Les compromissions
Il est commun dans les milieux militants d’utiliser les outils du système pour “mieux le combattre”. Cette logique ressemble à celle de “la fin justifie les moyens”. Nous n’avons aucun problème avec cette logique, mais nous appellons à une prudence, que nous ne voyons malheureusement pas souvent dans les collectifs, mouvements et stratégies que nous croisons. Effectivement, il nous semble qu’en réalité la logique est : la fin potentielle, peu importe la probabilité, justifie les moyens. Notre désacord réside principalement ici.
La justification de moyens implique que ceux-ci ne soient pas souhaitables sans l’objectif, mais qu’on les accepte comme compromis pour atteindre nos fin. Comment justifier de telles compromissions, quand la réalité des conditions matérielles du militantisme est si pauvre ? Comment, face à l’inefficacité des luttes, pouvons-nous justifier tant de compromissions ? Tant de caméras, militant·es exploité·es, t-shirt mais en coton bio, pulls, VSS câchées au nom de la stabilité, campagnes de com., mugs et tous les autres gadgets qui circulent dans les luttes. Tant de collectifs qui se sont effondrés, tant d’argent gaspillé, tant de personnes exploitées pour fabriquer ces objets, tant de logiques néocoloniales, d’extractivisme, pour quoi ? Augmenter nos chances ? Quel gachis, quel échec!
De plus, ces moyens s’alignent souvent avec les logiques capitalistes, avec les normes en vigueur en communication, développement de site web et de merchandising. Des logiques évidentes pour une petite bourgeoisie intellectuelle, représentante dominante des luttes occidentales. Leur réelle nécéssité, ce qui impliquerait l’absence d’alternatives, n’est pas questionnée, et les alternatives ne sont pas explorées. Une fois de plus, le système techno-productiviste se frotte les mains.
L’altruisme efficace
L’altruisme efficace est le paroxysme - ou tout au moins il doit s’en rapprocher - de la logique de “la fin justifie les moyens”. L’altruisme efficace a certes évolué ces dernières décennies, mais il soutient notamment l’idée qu’il faut travailler beaucoup et faire de grandes carrières pour maximiser son pouvoir d’agir de manière altruiste. Inilialement centrée sur le don d’argent, le mouvement plus académique soutient aujourd’hui qu’il vaut mieux, comme le promeut “80000 hours”, travailler plus dans des domaines politiques que de chercher à gagner beaucoup d’argent. Dans tout les cas, une approche similaire est assez commune dans les milieux militants. Cette vision est souvent présentée de l’une des manières suivantes:
- Je veux faire ces études et cette carrière pour avoir de l’argent pour financer les associations de mon choix et aider les luttes ;
- Je veux m’investir en politique pour légiférer et essayer de changer les choses en interne ;
- Ce mode de vie me permet de contribuer et de financer des luttes.
Parfois c’est une approche hybride qui est défendue. Il nous semble que malgré sa dénomination, cette stratégie n’est pas très efficace. Elle souffre de plusieurs embûches, rarement conscientisées par ses adeptes. Premièrement, elle sous-estime la capacité du système d’absorber et de compromettre les personnes qui s’y adonnent, malgré leurs intentions. La puissance de ce conformisme est très difficile à contrer. Noam Chomsky en parle notamment dans son livre La Fabrication du consentement où il évoque aussi une deuxième embûche. La deuxième difficulté est d’arriver à un poste de pouvoir et d’y rester. Imagonons le cas d’une personne qui a réussi à ne pas être corrompu·e, qui a réussi à grimper les échelons et qui est maintenant au poste qu’elle convoitait pour pouvoir apporter les changements souhaités. Cela a pris des années, souvent des décennies, pour arriver là, et une fois en place, le moindre faux mouvement, non-conformisme apparent où “anormalité” peut tout gâcher. Effectivement, comme l’exemplifie Chomsky dans son ouvrage, une fois à cette place, il est difficile d’accomplir ses fins sans être éliminé·e par les mécanisme de résilience du système. L’efficacité se voit particulièrement bridée.
Effectivement, pour maintenir une position où une personne a un bon salaire, des compromissions sont nécéssaire. Il est difficile de rester dans une telle position où le capital économique nécéssite de s’accompagner d’un capital social, symbolique et culturel, car ils nécessitent à leur tour des moyens considérables. Si les deux embûches précédement explicitées sont surmontées, il faut, tout en maintenant son poste, trouver un équilibre entre les dépenses, les compromissions et les bénéfice finaux capitalisables au sein des luttes.
De plus, les objectifs de l’altruisme efficace sont structurés par la vision du monde de ses adeptes. Des adeptes qui baignent dans des contextes systémiques qui ne peuvent que déteindre sur elleux. Même si l’on est pas né·e avec les privilèges caractéristiques de ces milieux, on ne peut en ressortir inchangé·e. Le seul objectif reste donc d’en sortir læ moins corrompu·e possible. Ce n’est malheureusement pas si simple, comme de nombreuses figures de ce mouvement le montrent. Les objectifs promus par l’altruisme efficace souffrent donc de la vision chauviniste et culturelle d’une bourgoisie altruiste6,7.
Notre militantisme au Mallouestan
Notamment pour ces raisons qui, malgré leur manque d’exhaustivité, nous semblent suffisantes pour ne pas croire à la capacité du militantisme offensif actuel (texte écrit en janvier 2025) de changer de manière significative et suffisante les conditions matérielles soutenant les divers·es injustices, dominations et enjeux sociaux structurels, nous ne nous y engageons pas. Nous pensons que participer à ce genre d’actions, de stratégie ou de mouvement dans l’espoir de changements ou à des fins personnnelles (thérapeutique, identitaire) est au mieux une perte de temps, et au pire une mascarade de complicité avec nos ennemi·es politiques.
Ceci n’est pas pour juger les individu·es prenant part à ce qui est décrit, mais pour expliquer que cette réalité existe malgré des efforts, des sacrifices et les intentions honnorables des personnes composant ces mouvements (on vise ici majoritairement les mouvements offensifs). Notre souhait serait que la masse militante deviennent plus compétente, moins coruptible et plus pérenne. Que tous les efforts et intentions aboutissent à des changement pour toutes les victimes. Après tout, n’est-ce pas ce qui importe?
Nous voulons que les militant·es se préparent à l’échec des luttes plûtot que de parier sur l’improbable tout en sachant les faibles perspectives. Pourquoi est-ce que 90% des militant·es luttent pour l’issue la moins probable ? Ne vaudrait-il mieux pas agir en minimisant l’impact, les victimes et les enjeux de l’échec ? C’est ce que nous pensons au Mallouestan.
Au Mallouestan, nous nous voyons soutenir ces changements dans les milieux militants ; fournir un lieu de réflexion (voir texte “Recherche”) et de formation (voir texte “Partage et transmission”) ; mettre à disposition un lieu où les conditions matérielles sont compatible avec des luttes pérennes ; et de nombreux autres aspects. Notre temps sur le lieu, dans le cadre où nous l’avons inscrit, est un temps consacré à du militantisme défensif, notamment de solidarité (voir texte “Solidarité”).
De nombreux·ses membres du Mallouestan envisagent, si les conditions matérielles le permettent – autrement dit si les conditions matérielles laissent entrevoir une efficacité – de participer à des luttes offensive de type guerre de mouvement. Comme l’explicite Gramsci, nous pensons que malheureusement ce serait dans une situation où nos ennemi·es politiques seraient fragilisé·es par de multiples crises. Nous espérons voir cette réalité, mais restons dubitatif·ves sur la probabilité que cela se produise prochainement (Gramsci voyait cette échéance a plusieurs siècles).
En attendant cette possibilité, nous sommes convaincu·es que le mode de vie du Mallouestan permet d’augmenter notre résilience (voir les textes “Autonomie”, “Risques et Perils”) ; d’augmenter notre indépendance à l’égard des ennemi·es politiques ; d’augmenter nos compétences générales et militantes, d’aider et de soutenir de nombreuses victimes des problèmes combattus ; et enfin de minimiser notre collaboration et nos compromissions avec un système ignoble.
Malgré notre opposition actuelle aux luttes offensives, nous ne souhaitons pas discriminer notre soutien en fonction des statégie choisies. Nous nous sommes lié·es à divers collectifs sans tenir compte de ce critère. Nous ne partageons ni leurs espoirs, ni les risques encourus, mais nous acceptons également qu’il serait dangeureux de hisser en absolue notre analyse.
Conclusion
Ce texte explicite donc nos réserves et oppositions à l’égard du militantisme offensif que l’on a défini. Nous proposons une grille d’analyse inspirée de Gramsci. Nous soulevons les problèmes de turn-over militant, d’enjeux identitaires, de manque d’efficacité et de corruptibilité. Nous montrons également le danger du “bougisme” militant qui paraît subversif mais qui, malgré les intentions, joue en faveur de nos ennemis politiques en mettant plus d’outils dans leurs mains. Nous émettons également notre avis sur le militantisme défensif que nous défendons, tout en partageant les risques sur le long terme.
Nous partageons également la vision militante du Mallouestan qui se projette dans une lutte défensive en attendant la possibilité de se tourner vers des méthodes plus offensives, par exemple dans le cas où des conditions matérielles favorables se présenteraient. Nous avons également souligné les apports de notre mode de vie et du cadre au Mallouestan aux différentes questions soulevées.
Notes et références
- Comme explicité dans cette vidéo
- Par système nous entendons les logiques et mécanismes techno-industriel.les mondialisé.es et celleux qui les soutiennent.
- Le philosophe français Michel Clouscard aborde ces sujets notamments dans Le Capital de la séduction.
- Études sur la priorité accordé aux enjeux climatiques
- Full spectrum résistance tome 1, Aric McBay
- https://jacobin.com/2022/10/peter-singer-moral-philosophy-status-quo-poverty-capitalism-charity-ethics
- https://www.radicalphilosophy.com/article/against-effective-altruism